DR
Centenaire
Par Bachir Bourras
Publié le
Pour célébrer les 100 ans de la mort de Jacques Rivière (1886-1925), la collection Bouquins publie l’essentiel du travail critique et romanesque de ce célèbre inconnu condamné à vivre à l’ombre de « La Nouvelle Revue française », dont il fut le directeur de 1919 à 1925.
La collection Bouquins continue son appréciable travail d’exhumation des oubliés. Preuve bien vivante que les classiques ne meurent jamais : il suffit de passer sur leur couverture un souffle résurrectionnel. Après le journal intégral de Julien Green (en cours de publication depuis 2019), les essais de Casanova, ou la critique de Stefan Zweig, pour les plus récents, Bouquins récidive en offrant au public l’essentiel de l’œuvre de Jacques Rivière.
Dans ce volume sobrement intitulé Critique et création, le lecteur découvrira l’éclectisme et l’acuité d’analyse de celui qui fut modestement et passionnément le héraut d’une jeune revue promise à un bel avenir : La Nouvelle Revue française.
À LIRE AUSSI : “Elle le peut, mais elle infuse lentement” : la littérature peut-elle (encore) transformer le monde ?
Fondée en 1909 par un « sextumvirat » de jeunes auteurs autour de la figure d’André Gide (1869-1951), celle que l’on connaît de nos jours sous l’acronyme NRF se veut défenseur d’une avant-garde littéraire et s’imposera comme un maillon irrévocable de notre histoire littéraire. La revue trouvera en son jeune directeur un oblat d’une grande fidélité, à tel point que leurs parcours et leurs idées se confondront. De fait, le situer dans l’espace agrandi de la littérature revient à le situer dans celui, restreint, du conclave de la NRF.
Portrait d’un inconnu
Mais qui était Jacques Rivière ? Comme pour tous les hommes illustres, il y a d’abord la sèche biographie, qui ne préjuge et n’annonce rien de la force intrinsèque de l’homme. Né en 1886, il meurt brutalement, et dirons-nous tragiquement, d’une fièvre typhoïde qui, après s’être invitée dans la famille Rivière par la bonne de la maison, et s’être essayée au fils puis à la mère, finit par le gagner avant de l’emporter à l’âge de 38 ans, en 1925. Il avait épousé en 1909 (année de la création de la NRF, soit dit en passant) Isabelle Fournier, sœur d’un certain Henri Fournier, rencontré sur les bancs de l’École normale supérieure, et qui deviendra l’auteur du Grand Meaulnes sous le nom de plume d’Alain-Fournier (1886-1914).
Depuis 1919, il était le secrétaire de rédaction puis le directeur de la NRF après une rencontre mémorable avec André Gide, dont il gardait un souvenir chaleureux. On pourrait pousser la recherche plus loin. Mais aucun élément biographique ne semble apporter la réponse à une question qui se fait de plus en plus pressante : qui était vraiment Jacques Rivière ?
À LIRE AUSSI : Patrick Chamoiseau : “La littérature ne peut pas ignorer les souffrances, les atteintes à l’humain et à la dignité”
Au regard de la sublime préface personnelle de Jean-Yves Tadié, la question fait aveu d’échec. Car les rapports que nous entretenons avec les auteurs témoignent contre nous devant notre époque. Le temps où un adolescent se plongeait avec délectation dans les écrits de l’auteur d’Aimée semble révolu. Pour bon nombre d’entre nous, et a fortiori de nos plus jeunes, Jacques Rivière est un inconnu. Absents des manuels scolaires comme d’un certain nombre d’histoires littéraires, ses livres, à peine réédités, sont réservés à quelques happy few.
Or, ce portrait pessimiste trouvera un saisissant contrepoint dans le travail de contextualisation offert par cette réédition. Les formules glanées révèlent un homme d’une capacité d’analyse, et d’une intelligence hors pair : selon Jean-Yves Tadié, il était « un parfait amateur, sans étiquette, sans fil à la patte, amateur, mais au sens de celui qui aime, non de celui qui n’est qu’un fumiste ». Paul Claudel (1868-1955) le décrit à Francis Jammes (1868-1938) comme « remarquablement pénétrant et intelligent ».
Rivière était un être sensitif, une intelligence cultivée et puisée dans la lecture assidue de l’œuvre de Maurice Barrès (1862-1923), découvert durant l’été 1905, alors qu’il n’avait que 19 ans. De là une « sensibilité intellectuelle » nourrissant une « intelligence sensible », selon l’heureuse formule d’Ariane Charton, qu’il n’aura de cesse d’essayer sur les auteurs.
La « méthode » Rivière
« Se comprendre et comprendre les autres sont les seules occupations qui aient un sens dans la vie », déclare-t-il dans le bel hommage rendu à Marcel Proust (1871-1922). On comprend ce qui aura charmé le jeune homme dans la création de cette Nouvelle Revue française, jusqu’à en prendre la direction. La « violente pudeur littéraire » exhalée par deux de ses fondateurs, André Gide et Jean Schlumberger (1877-1968), accouplée à « une prédominance chez eux sur tous les soucis esthétiques d’un souci moral », ouvrait les voies à un nouvel idéal, basé sur une « honnêteté de l’écrivain » et une « probité des soucis de composition ». (« La Nouvelle Revue française. Ses origines, son programme »)
Compréhension, analyse et connaissance sont les trois vertus cardinales de sa « méthode ». Mais avant tout, Rivière est un sensitif. Engagé dans un rapport personnel et intime qui l’engage pleinement avec les auteurs, il parle des livres « avec l’enthousiasme de l’amour ; et donc avec une certaine naïveté. »
Doté d’une lucidité sans faille, Rivière avance dans les champs de l’art (musique, peinture et littérature) et de la politique avec une même inquiétude qui lui fait passer au crible les êtres et les choses. L’« insécurité universelle » est une réalité pour celui qui a connu les tranchées de la guerre de 14. Mais au-delà des marasmes et des troubles, il sait aussi se faire prophète.
À LIRE AUSSI : Pourquoi ça marche ? On a lu “La Femme de ménage” de Freida McLadden, le carton du moment en librairie
Fort de cet « art merveilleux de formuler et de pressentir » dont lui sait gré Alain-Fournier, de constat en constat, une vérité se profile : selon lui, en faisant fi de toute considération sérieuse, notamment métaphysique, le champ littéraire, et le roman en particulier, acte une altération de sa portée universelle : « Il me semble voir commencer, simultanément avec Dada, un âge où la question du sens de la littérature cessera complètement de préoccuper ceux qui la feront, un âge où l’écrivain ne se croira plus désigné pour une fonction transcendante, mais travaillera à fixer l’aspect des choses le plus voisin de lui. […] Ce ne seront plus des révélations qui seront attendues de lui, mais des renseignements heureusement formulés sur l’homme, sur la vie, sur notre voyage en ce monde. »
Comment ne pas constater que cet âge annoncé de la superficialité, nous le vivons ? Peut-être même avons-nous franchi un palier supplémentaire vers l’atrophie du moi, qui ne voit dans l’objet littéraire qu’un miroir tendu à sa seule vanité ?
***
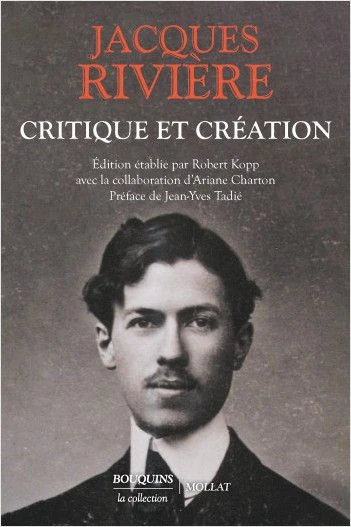
Critique et création, Jacques Rivière, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1 152 pages, 32 euros.
Nos abonnés aiment
Plus de Culture
Votre abonnement nous engage
En vous abonnant, vous soutenez le projet de la rédaction de Marianne : un journalisme libre, ni partisan, ni pactisant, toujours engagé ; un journalisme à la fois critique et force de proposition.
Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne




